
Chapitre 5, «la meilleure politique», sous chapitres 154 à 175 de l’encyclique du Pape François, Fratelli tutti.
Il faut avoir le courage de reconnaître que, sans eux, « la démocratie s’atrophie, devient un nominalisme, une formalité, perd de sa représentativité, se désincarne car elle laisse le peuple en dehors, dans sa lutte quotidienne pour la dignité, dans la construction de son destin
La meilleure politique
Une meilleure politique, mise au service du vrai bien commun, est nécessaire pour permettre le développement d’une communauté mondiale, capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l’amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd’hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent.
Populismes et libéralismes
Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes, qui les utilisent de façon démagogique à leurs fins, ou sous des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants. Dans les deux cas, on perçoit des difficultés à penser un monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde, qui intègre les plus faibles et qui respecte les différentes cultures.
Populaire ou populiste
Au cours des dernières années, le terme “populisme” ou “populiste” a envahi les médias et le langage en général. Il perd ainsi la valeur qu’il pourrait avoir et devient l’une des polarités de la société divisée, à telle enseigne qu’on prétend classer toutes les personnes, les groupes, les sociétés et les gouvernements à partir d’une division binaire : “populiste” ou “non populiste”. Il n’est plus possible qu’une personne exprime son opinion sur un thème sans qu’on essaye de la classer dans l’un des deux camps, parfois pour la discréditer injustement ou pour l’exalter à l’excès.
La prétention d’établir le populisme comme une grille de lecture de la réalité sociale a une autre faiblesse : elle ignore la légitimité de la notion de peuple. La tentative de faire disparaître du langage cette catégorie pourrait conduire à éliminer le terme même de ‘‘démocratie’’ – c’est à-dire le “gouvernement du peuple” –. Même si on ne veut pas affirmer que la société est plus que la simple somme des individus, on a besoin du vocable “peuple”.
La réalité, c’est qu’il y a des phénomènes sociaux qui structurent les majorités, qu’il existe des mégatendances et des prospections communautaires. On peut également penser aux objectifs communs, au-delà des différences, pour façonner un projet commun. Enfin, il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si cela ne devient pas un rêve collectif. Tout cela est exprimé par le substantif “peuple” et par l’adjectif “populaire”. S’ils n’étaient pas pris en compte – avec une critique solide de la démagogie –, on laisserait de côté un aspect fondamental de la réalité sociale.
Il existe, en effet, un malentendu : « Peuple n’est pas une catégorie logique, ni une catégorie mystique, si nous le comprenons dans le sens où tout ce que le peuple fait est bon, ou bien dans le sens où le peuple est une catégorie angélique. Il s’agit d’une catégorie mythique […]. Lorsque vous expliquez ce qu’est un peuple, vous utilisez des catégories logiques parce que vous devez l’expliquer : vraiment, c’est nécessaire. Mais vous n’expliquez pas le sens d’appartenance à un peuple. Le terme peuple a quelque chose de plus qu’on ne peut pas expliquer de manière logique. Faire partie d’un peuple, c’est faire partie d’une identité commune faite de liens sociaux et culturels. Et cela n’est pas quelque chose d’automatique, tout au contraire : c’est un processus lent, difficile…vers un projet commun ».

Il y a des dirigeants populaires capables d’interpréter le sentiment d’un peuple, sa dynamique culturelle et les grandes tendances d’une société. La fonction qu’ils exercent, en rassemblant et en dirigeant, peut servir de base pour un projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité d’accorder une place à d’autres en vue du bien commun. Mais elle se mue en un populisme malsain lorsqu’elle devient l’habileté d’un individu à captiver afin d’instrumentaliser politiquement la culture du peuple, grâce à quelque symbole idéologique, au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir. Parfois, on cherche à gagner en popularité en exacerbant les penchants les plus bas et égoïstes de certains secteurs de la population. Cela peut s’aggraver en devenant, sous des formes grossières ou subtiles, un asservissement des institutions et des lois.
Les groupes populistes fermés défigurent le terme “peuple”, puisqu’en réalité ce dont il parle n’est pas le vrai peuple. En effet, la catégorie de ‘‘peuple’’ est ouverte. Un peuple vivant, dynamique et ayant un avenir est ouvert de façon permanente à de nouvelles synthèses intégrant celui qui est différent. Il ne le fait pas en se reniant lui-même, mais en étant disposé au changement, à la remise en question, au développement, à l’enrichissement par d’autres ; et ainsi, il peut évoluer. Un autre signe de la dégradation du leadership populaire, c’est l’immédiateté. On répond à des exigences populaires afin de garantir des voix ou une approbation, mais sans progresser dans une tâche ardue et constante qui offre aux personnes les ressources pour leur développement, afin qu’elles puissent gagner leur vie par leur effort et leur créativité. Dans ce sens, j’ai clairement affirmé qu’est « loin de moi la proposition d’un populisme irresponsable ».
D’une part, vaincre les inégalités suppose le développement économique, en exploitant les possibilités de chaque région et en assurant ainsi une équité durable. D’autre part, « les plans d’assistance qui font face à certaines urgences devraient être considérés seulement comme des réponses provisoires ».
La grande question, c’est le travail. Ce qui est réellement populaire – parce qu’il contribue au bien du peuple –, c’est d’assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d’initiative, ses forces. C’est la meilleure aide que l’on puisse apporter à un pauvre, c’est le meilleur chemin vers une existence digne. C’est pourquoi j’insiste sur le fait qu’« aider les pauvres avec de l’argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail ». Les mécanismes de production ont beau changer, la politique ne peut pas renoncer à l’objectif de faire en sorte que l’organisation d’une société assure à chacun quelque moyen d’apporter sa contribution et ses efforts. En effet, « il n’existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail »
Dans une société réellement développée, le travail est une dimension inaliénable de la vie sociale, car il n’est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une voie pour l’épanouissement personnel, en vue d’établir des relations saines, de se réaliser, de partager des dons, de se sentir coresponsable de l’amélioration du monde et en définitive de vivre comme peuple.

Valeurs et limites des visions libérales
La catégorie de peuple, qui intègre une valorisation positive des liens communautaires et culturels, est généralement rejetée par les visions libérales individualistes où la société est considérée comme une simple somme d’intérêts qui coexistent. Elles parlent de respect des libertés, mais sans la racine d’une histoire commune. Dans certains contextes, il est fréquent de voir traiter de populistes tous ceux qui défendent les droits des plus faibles de la société. Pour ces visions, la catégorie de peuple est une mythification de quelque chose qui, en réalité, n’existe pas. Toutefois, il se crée ici une polarisation inutile, car ni l’idée de peuple ni celle de prochain ne sont des catégories purement mythiques ou romantiques qui excluent ou méprisent l’organisation sociale, la science et les institutions de la société civile.
La charité réunit les deux dimensions – mythique et institutionnelle – puisqu’elle implique un processus efficace de transformation de l’histoire qui exige que tout soit intégré : notamment les institutions, le droit, la technique, l’expérience, les apports professionnels, l’analyse scientifique, les procédures administratives.
En effet, « il n’y a […] de vie privée que protégée par un ordre public ; le foyer n’a d’intimité qu’à l’abri d’une légalité, d’un état de tranquillité fondé sur la loi et sur la force et sous la condition d’un bien-être minimum assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice sociale, la citoyenneté politique ».
La vraie charité est capable d’intégrer tout cela dans son déploiement et doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle ; elle est aussi capable d’atteindre un frère ou une sœur éloignés, voire ignorés, à travers les différentes ressources que les institutions d’une société organisée, libre et créative sont en mesure de créer.
Si nous prenons ce cas, même le bon Samaritain a eu besoin de l’existence d’une auberge qui lui a permis de résoudre ce que, tout seul, en ce moment-là, il n’était pas en mesure d’assurer. L’amour du prochain est réaliste et ne dilapide rien qui soit nécessaire pour changer le cours de l’histoire en faveur des pauvres. Autrement, des idéologies de gauche ou des pensées sociales en viennent quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de faire inefficaces qui ne profitent qu’à une petite minorité. Dans le même temps, la multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns.
Cela révèle qu’il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays pauvres. Vice-versa, cela implique qu’il n’y a pas qu’une seule sortie possible, une méthodologie acceptable unique, une recette économique qui peut être appliquée uniformément pour tous, et cela suppose que même la science la plus rigoureuse peut proposer des voies différentes.

Tout cela serait précaire si nous perdions la capacité de percevoir la nécessité d’un changement dans les cœurs humains, dans les habitudes et dans les modes de vie. C’est ce qui se produit lorsque la propagande politique, les médias et les faiseurs d’opinion publique persistent à encourager une culture individualiste et naïve face aux intérêts économiques effrénés et à l’organisation des sociétés au service de ceux qui ont déjà trop de pouvoir.
Voilà pourquoi ma critique du paradigme technocratique n’implique pas que nous pourrions nous trouver en sécurité en essayant uniquement de contrôler ses travers. Car le plus grand danger ne réside pas dans les choses, dans les réalités matérielles, dans les organisations, mais dans la manière dont les personnes les utilisent.
Le problème, c’est la fragilité humaine, la tendance constante à l’égoïsme de la part de l’homme qui fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle “concupiscence” : le penchant de l’être humain à s’enfermer dans l’immanence de son moi, de son groupe, de ses intérêts mesquins. Cette concupiscence n’est pas un défaut de notre temps. Elle existe depuis que l’homme est homme et simplement se transforme, prend des formes différentes à chaque époque ; et, somme toute, elle utilise les instruments que le moment historique met à sa disposition. Mais il est possible de la dominer avec l’aide de Dieu.
Le travail d’éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de penser la vie humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines, de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ses inégalités, à ses déviations, aux abus des pouvoirs économiques, technologiques, politiques ou médiatiques. Certaines visions libérales ignorent ce facteur de la fragilité humaine et imaginent un monde obéissant à un ordre déterminé qui, à lui seul, pourrait garantir l’avenir et la résolution de tous les problèmes.
Le marché à lui seul ne résout pas tout, même si, une fois encore, l’on veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibéral. Il s’agit là d’une pensée pauvre, répétitive, qui propose toujours les mêmes recettes face à tous les défis qui se présentent. Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-même, en recourant aux notions magiques de “ruissellement” ou de “retombées” – sans les nommer – comme les seuls moyens de résoudre les problèmes sociaux. Il ne se rend pas compte que le prétendu ruissellement ne résorbe pas l’inégalité, qu’il est la source de nouvelles formes de violence qui menacent le tissu social.
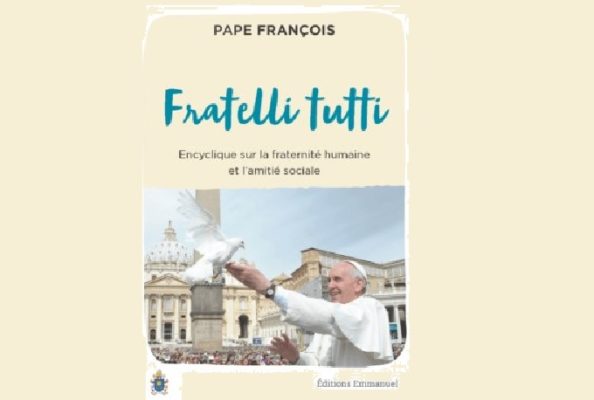
D’une part, une politique économique active visant à « promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale » s’impose, pour qu’il soit possible d’augmenter les emplois au lieu de les réduire. La spéculation financière, qui poursuit comme objectif principal le gain facile, continue de faire des ravages.
D’autre part, « sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Aujourd’hui, c’est cette confiance qui fait défaut ». Le résultat final n’a pas correspondu aux prévisions et les recettes dogmatiques de la théorie économique dominante ont montré qu’elles n’étaient pas infaillibles. La fragilité des systèmes mondiaux face aux pandémies a mis en évidence que tout ne se résout pas avec la liberté de marché et que, outre la réhabilitation d’une politique saine qui ne soit pas soumise au diktat des finances, il faut « replacer au centre la dignité humaine et, sur ce pilier, doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin ».
Dans certaines visions économiques étriquées et monochromatiques, il ne semble pas y avoir de place, par exemple, pour les mouvements populaires rassemblant des chômeurs, des travailleurs précaires et informels ainsi que beaucoup d’autres personnes qui n’entrent pas facilement dans les grilles préétablies. En réalité, elles génèrent plusieurs formes d’économie populaire et de production communautaire. Il faut penser à la participation sociale, politique et économique de telle manière « qu’elle [inclue] les mouvements populaires et anime les structures de gouvernement locales, nationales et internationales, avec le torrent d’énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d’un avenir commun ». Et en même temps, il convient de travailler à ce que « ces mouvements, ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète, confluent, soient davantage coordonnées, se rencontrent ».
Mais sans trahir leurs caractéristiques, parce que ce « sont des semeurs de changement, des promoteurs d’un processus dans lequel convergent des millions de petites et grandes actions liées de façon créative, comme dans une poésie ».
En ce sens, les “poètes sociaux” sont ceux qui travaillent, qui proposent, qui promeuvent et qui libèrent à leur manière. Grâce à eux, un développement humain intégral sera possible, qui implique que soit dépassée « cette idée de politiques sociales conçues comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres, et encore moins insérée dans un projet réunissant les peuples ».
Bien qu’ils dérangent, bien que quelques “penseurs” ne sachent pas comment les classer, il faut avoir le courage de reconnaître que, sans eux, « la démocratie s’atrophie, devient un nominalisme, une formalité, perd de sa représentativité, se désincarne car elle laisse le peuple en dehors, dans sa lutte quotidienne pour la dignité, dans la construction de son destin ».

Le pouvoir international
Je me permets de répéter que « la crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d’une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques, et pour une nouvelle régulation de l’activité financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n’y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde ».
Pire, les réelles stratégies, développées ultérieurement dans le monde, semblent avoir visé plus d’individualisme, plus de désintégration, plus de liberté pour les vrais puissants qui trouvent toujours la manière de s’en sortir indemnes.
Je voudrais souligner que « donner à chacun ce qui lui revient, en suivant la définition classique de la justice, signifie qu’aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout-puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques ou de leurs regroupements sociaux. La distribution de fait du pouvoir – surtout politique, économique, de défense, technologique – entre une pluralité de sujets ainsi que la création d’un système juridique de régulation des prétentions et des intérêts, concrétise la limitation du pouvoir. Le panorama mondial aujourd’hui nous présente, cependant, beaucoup de faux droits, et – à la fois – de grands secteurs démunis, victimes plutôt d’un mauvais exercice du pouvoir ».
Le XXIe siècle « est le théâtre d’un affaiblissement du pouvoir des États nationaux, surtout parce que la dimension économique et financière, de caractère transnational, tend à prédominer sur la politique. Dans ce contexte, la maturation d’institutions internationales devient indispensable, qui doivent être plus fortes et efficacement organisées, avec des autorités désignées équitablement par accord entre les gouvernements nationaux, et dotées de pouvoir pour sanctionner ».
Lorsqu’on parle de la possibilité d’une forme d’autorité mondiale régulée par le droit, il ne faut pas nécessairement penser à une autorité personnelle. Toutefois, on devrait au moins inclure la création d’organisations mondiales plus efficaces, dotées d’autorité pour assurer le bien commun mondial, l’éradication de la faim et de la misère ainsi qu’une réelle défense des droits humains fondamentaux.

Dans ce sens, je rappelle qu’il faut une réforme « de l’Organisation des Nations Unies comme celle de l’architecture économique et financière internationale en vue de donner une réalité concrète au concept de famille des Nations ».
Sans doute cela suppose des limites juridiques précises pour éviter que cette autorité ne soit cooptée par quelques pays et en même temps pour empêcher des impositions culturelles ou la violation des libertés fondamentales des nations les plus faibles à cause de différences idéologiques. En effet, « la Communauté Internationale est une communauté juridique fondée sur la souveraineté de chaque État membre, sans liens de subordination qui nient ou limitent son indépendance ».
Mais « le travail des Nations Unies, à partir des postulats du Préambule et des premiers articles de sa Charte constitutionnelle, peut être considéré comme le développement et la promotion de la primauté du droit, étant entendu que la justice est une condition indispensable pour atteindre l’idéal de la fraternité universelle. […] Il faut assurer l’incontestable état de droit et le recours inlassable à la négociation, aux bons offices et à l’arbitrage, comme proposé par la Charte des Nations Unies, vraie norme juridique fondamentale ». Il est à éviter que cette Organisation soit délégitimée, parce que ses problèmes ou ses insuffisances peuvent être affrontés ou résolus dans la concertation.
Il faut du courage et de la générosité pour établir librement certains objectifs communs et assurer le respect dans le monde entier de certaines normes fondamentales. Afin que cela soit réellement utile, on doit observer « l’exigence de respecter les engagements souscrits – pacta sunt servanda – », de telle sorte qu’on évite « la tentation de recourir au droit de la force plutôt qu’à la force du droit ».
Cela exige une consolidation des « instruments normatifs pour la solution pacifique des controverses [qui] doivent être repensés de façon à renforcer leur portée et leur caractère obligatoire ». Parmi ces instruments juridiques, les accords multilatéraux entre les États doivent avoir une place de choix, car ils garantissent, mieux que les accords bilatéraux, la sauvegarde d’un bien commun réellement universel et la protection des États les plus faibles.
Grâce à Dieu, beaucoup de regroupements et d’organisations de la société civile aident à pallier les faiblesses de la Communauté Internationale, son manque de coordination dans des situations complexes, son manque de vigilance en ce qui concerne les droits humains fondamentaux et les situations très critiques de certains groupes. Ainsi, le principe de subsidiarité devient une réalité concrète garantissant la participation et l’action des communautés et des organisations de rang inférieur qui complètent l’action de l’État. Très souvent, elles accomplissent des efforts admirables en pensant au bien commun ; et certains de leurs membres arrivent à réaliser des gestes vraiment héroïques qui révèlent la beauté dont notre humanité est encore capable.
