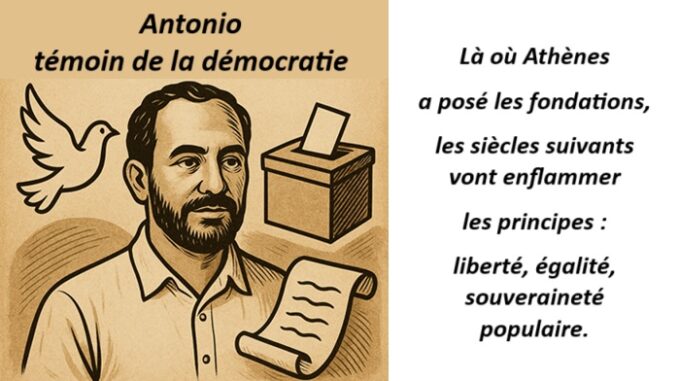
Brésil, vers 1840. Une chaleur dense enveloppe la ville de Recife. Les esclaves marchent en silence, les femmes obéissent sans nom. Antonio longe une ruelle bordée de bougainvilliers. Au fond, une maison modeste. Une voix s’élève — celle d’une femme qui lit Rousseau… en portugais.
Antonio, témoin de la démocratie épisode 9
Nísia Floresta. Éducatrice, écrivaine, pionnière du féminisme brésilien. Elle traduit les philosophes européens pour les femmes de son pays, écrit sur les droits, l’instruction, et l’égalité dans un monde qui ne lui a rien offert.
Dialogue : Traduire, c’est résister
Antonio : Vous traduisez les penseurs des Lumières… Mais dans ce Brésil colonial, qui vous écoute ?
Nísia (avec une intensité farouche) : Les esclaves qui rêvent, les filles qui lisent en cachette, les mères qui ne veulent plus plier. Mon audience n’est pas noble… mais elle est nécessaire.
Antonio : Rousseau, Condorcet, Wollstonecraft… Pourquoi ces auteurs ?
Nísia : Parce qu’ils parlent de dignité. Même si leur monde ignore le nôtre, leurs mots peuvent être semés ici. Et je les plante comme graines.
Elle évoque son combat : enseigner aux filles, publier sous pseudonyme, dénoncer les injustices sans jamais renier sa voix. Elle est traductrice… mais aussi créatrice. Sa pensée métisse les Lumières et les douleurs du Brésil.
Antonio : Et si personne ne lit ?
Nísia (sourit) : Alors j’aurai écrit pour demain.
Une lumière cachée
Antonio regarde Nísia sortir des cahiers annotés. Il voit une lutte douce mais tenace. Pas de cortèges, pas d cris… seulement des phrases comme lanternes dans la nuit.
Avant de partir, elle lui tend un feuillet : “Que les femmes pensent et choisissent, voilà la vraie révolution.”
Antonio écrit dans son carnet : “Ici, la démocratie commence par un livre posé sur une table. Et une voix qui ne s’excuse pas d’exister.”
Nísia Floresta un peu plus
De son vrai nom Dionísia Gonçalves Pinto, était une pionnière du féminisme au Brésil au XIXe siècle. Née en 1810 à Papari (aujourd’hui appelée Nísia Floresta en son honneur) et décédée en 1885 à Rouen, elle a marqué l’histoire par son engagement en faveur des droits des femmes et de l’éducation féminine.
Ses contributions majeures :
- Première féministe brésilienne reconnue, elle a publié en 1832 Direitos das mulheres e injustiça dos homens, inspiré par Mary Wollstonecraft, pour défendre les droits des femmes.
- Elle a fondé le Colégio Augusto à Rio de Janeiro, une école pour filles qui proposait un enseignement scientifique et littéraire, rompant avec les normes éducatives centrées sur les tâches domestiques.
- Elle a écrit plusieurs ouvrages en portugais et en français, dont Opúsculo Humanitário (1853), salué par Auguste Comte, et Trois ans en Italie, suivis d’un voyage en Grèce (1864).
Une vie entre deux continents :
- Après un veuvage précoce, elle a voyagé en Europe pendant près de 30 ans, résidant notamment à Paris, Lisbonne et Rome.
- Elle a participé aux cercles intellectuels européens et a défendu une image plus nuancée du Brésil auprès des Européens.
Héritage :
- Son œuvre a longtemps été méconnue, mais elle est aujourd’hui redécouverte comme une figure centrale du féminisme latino-américain.
- Sa ville natale a été rebaptisée Nísia Floresta en 1954, lors du rapatriement de ses restes.
Une femme visionnaire, entre plume et combat, qui a su faire entendre sa voix dans un monde qui ne l’attendait pas.

Poster un Commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.