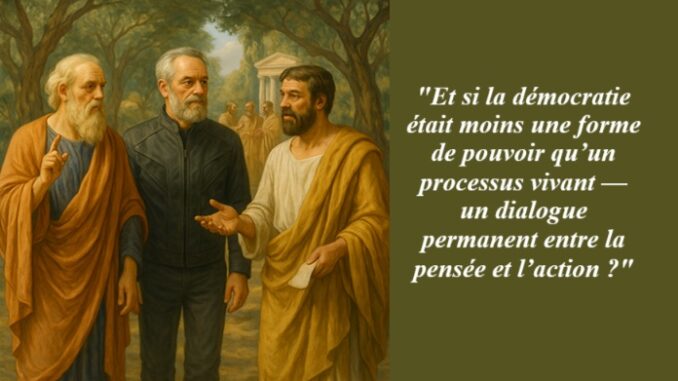
Antonio, voyageur du futur, émissaire d’un siècle en quête de sens, accompagné par Platon, le rêveur des Idées, vont à la rencontre d’Aristote son élève. Ils se dirigent vers une école discrète, nichée dans les oliviers. Là, ils croisent des hommes en toges, absorbés dans leurs dialogues. Parmi eux, Aristote, le cartographe du réel.
Antonio, témoin de la démocratie épisode 2
Antonio présente Platon à Aristote les invitant à dialoguer. Comment pensent-ils le citoyen, la justice, le pouvoir ? Il s’approche, guidé par une intuition : ici se joue la grande articulation entre utopie et pragmatisme. Entre la cité idéale… et celle qu’il faut gouverner.
Platon voit en la démocratie une illusion séduisante : un désordre né de la liberté excessive. Il parle d’un philosophe-roi, seul capable de diriger avec raison. Aristote, lui, se méfie des extrêmes. Il valorise la modération, l’équilibre des forces, le rôle essentiel de la classe moyenne.
Antonio les interroge :
« Et si la démocratie était moins une forme de pouvoir qu’un processus vivant — un dialogue permanent entre la pensée et l’action ? »
Les deux philosophes se regardent. Le débat commence.
Platon : Cette démocratie que tu évoques, étranger, ressemble à une mer sans capitaine. Trop de liberté engendre le chaos. Les désirs gouvernent là où la raison devrait régner.
Aristote (croisant les bras) : Platon voit des ombres. Moi, je vois des citoyens. La démocratie n’est pas parfaite, mais elle permet l’équilibre. Elle vit dans la modération — pas dans les extrêmes.
Antonio (regardant tour à tour les deux philosophes) : En 2025, nous avons le vote, les débats, des lois… Mais beaucoup se détournent. La démocratie semble exister, mais elle ne respire plus. Alors dites-moi — qu’est-ce qui donne vie à la démocratie ?
Platon : La connaissance. La formation des âmes. Si les ignorants décident, ce n’est plus la justice, c’est la foule.
Aristote : Et l’expérience. Le vivre ensemble, le débat, la mesure. Une démocratie n’est pas un rêve, c’est un système qu’il faut entretenir jour après jour.
Antonio (avec gravité) : Alors peut-être que notre erreur est d’avoir oublié que la démocratie est un effort — pas une évidence.
(Silence. Le vent agite les oliviers. Les deux philosophes se regardent.)
Aristote : Tu poses les bonnes questions. Reste, étranger. L’école est ouverte à ceux qui cherchent.
Rappel :
Platon (427–347 av. J.-C.) Philosophe grec majeur, disciple de Socrate, Platon est le penseur des Idées, du philosophe-roi et de la cité idéale. Il fonde l’Académie et développe une vision politique marquée par la quête de justice et la primauté de la raison sur les passions.
Aristote (384–322 av. J.-C.) Élève de Platon, il s’en éloigne en plaçant l’observation du réel au cœur de sa pensée. Fondateur du Lycée, Aristote valorise la modération, la vie politique concrète et le rôle central de la classe moyenne dans la stabilité de la cité.

Poster un Commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.